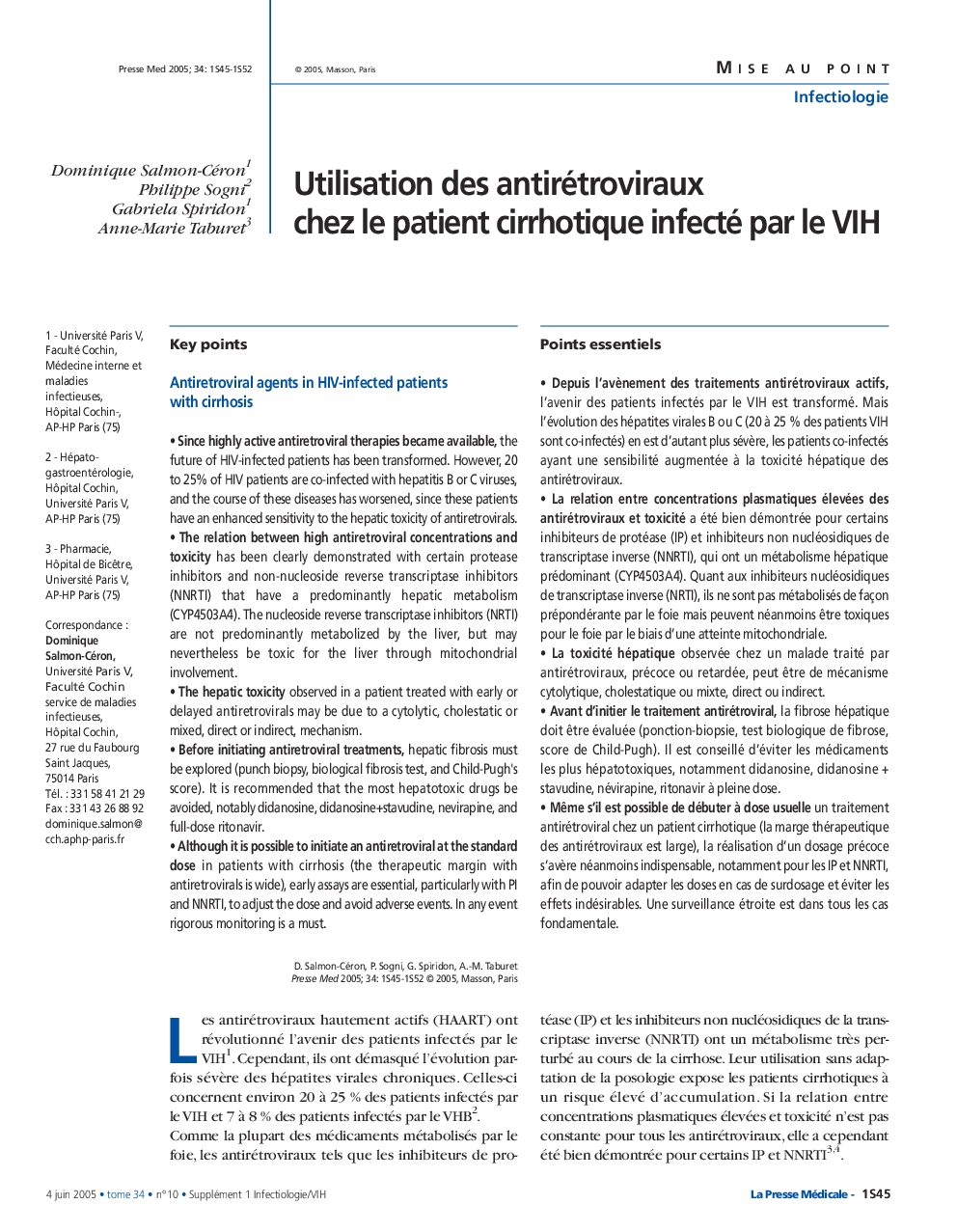| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 9303174 | La Presse Médicale | 2005 | 8 Pages |
Abstract
Points essentiels
- Depuis l'avènement des traitements antirétroviraux actifs, l'avenir des patients infectés par le VIH est transformé. Mais l'évolution des hépatites virales B ou C (20 à 25 % des patients VIH sont co-infectés) en est d'autant plus sévère, les patients co-infectés ayant une sensibilité augmentée à la toxicité hépatique des antirétroviraux.
- La relation entre concentrations plasmatiques élevées des antirétroviraux et toxicité a été bien démontrée pour certains inhibiteurs de protéase (IP) et inhibiteurs non nucléosidiques de transcriptase inverse (NNRTI), qui ont un métabolisme hépatique prédominant (CYP4503A4). Quant aux inhibiteurs nucléosidiques de transcriptase inverse (NRTI), ils ne sont pas métabolisés de façon prépondérante par le foie mais peuvent néanmoins être toxiques pour le foie par le biais d'une atteinte mitochondriale.
- La toxicité hépatique observée chez un malade traité par antirétroviraux, précoce ou retardée, peut être de mécanisme cytolytique, cholestatique ou mixte, direct ou indirect.
- Avant d'initier le traitement antirétroviral, la fibrose hépatique doit être évaluée (ponction-biopsie, test biologique de fibrose, score de Child-Pugh). Il est conseillé d'éviter les médicaments les plus hépatotoxiques, notamment didanosine, didanosine + stavudine, névirapine, ritonavir à pleine dose.
- Même s'il est possible de débuter à dose usuelle un traitement antirétroviral chez un patient cirrhotique (la marge thérapeutique des antirétroviraux est large), la réalisation d'un dosage précoce s'avère néanmoins indispensable, notamment pour les IP et NNRTI, afin de pouvoir adapter les doses en cas de surdosage et éviter les effets indésirables. Une surveillance étroite est dans tous les cas fondamentale.
- Depuis l'avènement des traitements antirétroviraux actifs, l'avenir des patients infectés par le VIH est transformé. Mais l'évolution des hépatites virales B ou C (20 à 25 % des patients VIH sont co-infectés) en est d'autant plus sévère, les patients co-infectés ayant une sensibilité augmentée à la toxicité hépatique des antirétroviraux.
- La relation entre concentrations plasmatiques élevées des antirétroviraux et toxicité a été bien démontrée pour certains inhibiteurs de protéase (IP) et inhibiteurs non nucléosidiques de transcriptase inverse (NNRTI), qui ont un métabolisme hépatique prédominant (CYP4503A4). Quant aux inhibiteurs nucléosidiques de transcriptase inverse (NRTI), ils ne sont pas métabolisés de façon prépondérante par le foie mais peuvent néanmoins être toxiques pour le foie par le biais d'une atteinte mitochondriale.
- La toxicité hépatique observée chez un malade traité par antirétroviraux, précoce ou retardée, peut être de mécanisme cytolytique, cholestatique ou mixte, direct ou indirect.
- Avant d'initier le traitement antirétroviral, la fibrose hépatique doit être évaluée (ponction-biopsie, test biologique de fibrose, score de Child-Pugh). Il est conseillé d'éviter les médicaments les plus hépatotoxiques, notamment didanosine, didanosine + stavudine, névirapine, ritonavir à pleine dose.
- Même s'il est possible de débuter à dose usuelle un traitement antirétroviral chez un patient cirrhotique (la marge thérapeutique des antirétroviraux est large), la réalisation d'un dosage précoce s'avère néanmoins indispensable, notamment pour les IP et NNRTI, afin de pouvoir adapter les doses en cas de surdosage et éviter les effets indésirables. Une surveillance étroite est dans tous les cas fondamentale.
Related Topics
Health Sciences
Medicine and Dentistry
Medicine and Dentistry (General)
Authors
Dominique Salmon-Céron, Philippe Sogni, Gabriela Spiridon, Anne-Marie Taburet,