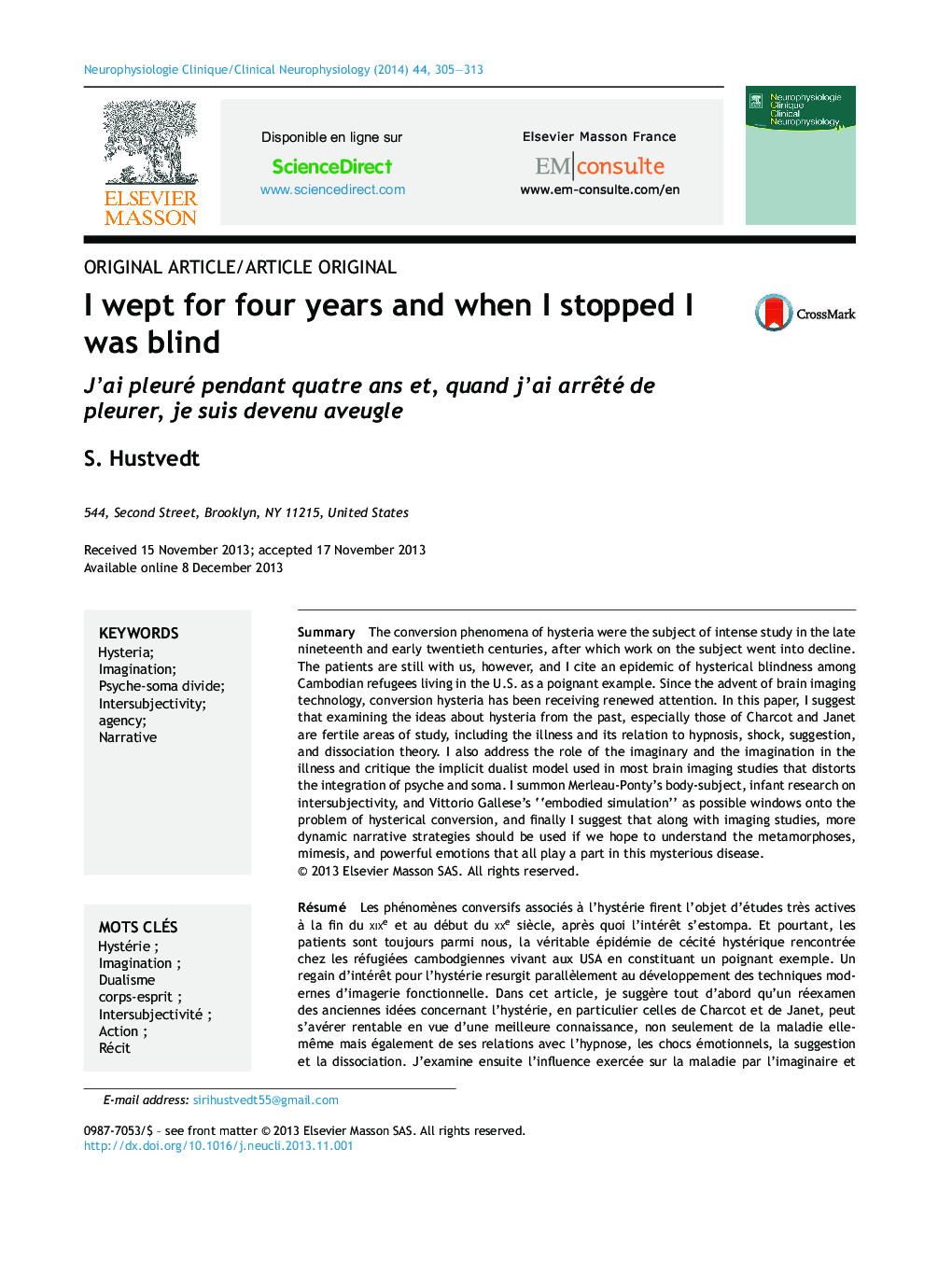| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 3082232 | Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology | 2014 | 9 Pages |
SummaryThe conversion phenomena of hysteria were the subject of intense study in the late nineteenth and early twentieth centuries, after which work on the subject went into decline. The patients are still with us, however, and I cite an epidemic of hysterical blindness among Cambodian refugees living in the U.S. as a poignant example. Since the advent of brain imaging technology, conversion hysteria has been receiving renewed attention. In this paper, I suggest that examining the ideas about hysteria from the past, especially those of Charcot and Janet are fertile areas of study, including the illness and its relation to hypnosis, shock, suggestion, and dissociation theory. I also address the role of the imaginary and the imagination in the illness and critique the implicit dualist model used in most brain imaging studies that distorts the integration of psyche and soma. I summon Merleau-Ponty's body-subject, infant research on intersubjectivity, and Vittorio Gallese's “embodied simulation” as possible windows onto the problem of hysterical conversion, and finally I suggest that along with imaging studies, more dynamic narrative strategies should be used if we hope to understand the metamorphoses, mimesis, and powerful emotions that all play a part in this mysterious disease.
RésuméLes phénomènes conversifs associés à l’hystérie firent l’objet d’études très actives à la fin du xixe et au début du xxe siècle, après quoi l’intérêt s’estompa. Et pourtant, les patients sont toujours parmi nous, la véritable épidémie de cécité hystérique rencontrée chez les réfugiées cambodgiennes vivant aux USA en constituant un poignant exemple. Un regain d’intérêt pour l’hystérie resurgit parallèlement au développement des techniques modernes d’imagerie fonctionnelle. Dans cet article, je suggère tout d’abord qu’un réexamen des anciennes idées concernant l’hystérie, en particulier celles de Charcot et de Janet, peut s’avérer rentable en vue d’une meilleure connaissance, non seulement de la maladie elle-même mais également de ses relations avec l’hypnose, les chocs émotionnels, la suggestion et la dissociation. J’examine ensuite l’influence exercée sur la maladie par l’imaginaire et l’imagination et critique le modèle dualiste, implicitement sous-jacent à toutes les études d’imagerie fonctionnelle, qui distord la compréhension des relations corps–esprit. Je fais ensuite appel aux concepts du « corps–sujet » de Merleau-Ponty et des « simulations incorporées » de Vittorio Gallese, ainsi qu’à la recherche de l’intersubjectivité chez le nourrisson, comme fenêtres possibles sur la problématique de la conversion hystérique. Enfin, je suggère que d’autres stratégies plus dynamiques basées sur le récit devraient être utilisées, parallèlement aux études d’imagerie, en vue de comprendre les métamorphoses, imitations et puissantes émotions qui toutes font partie intégrante de cette mystérieuse maladie.