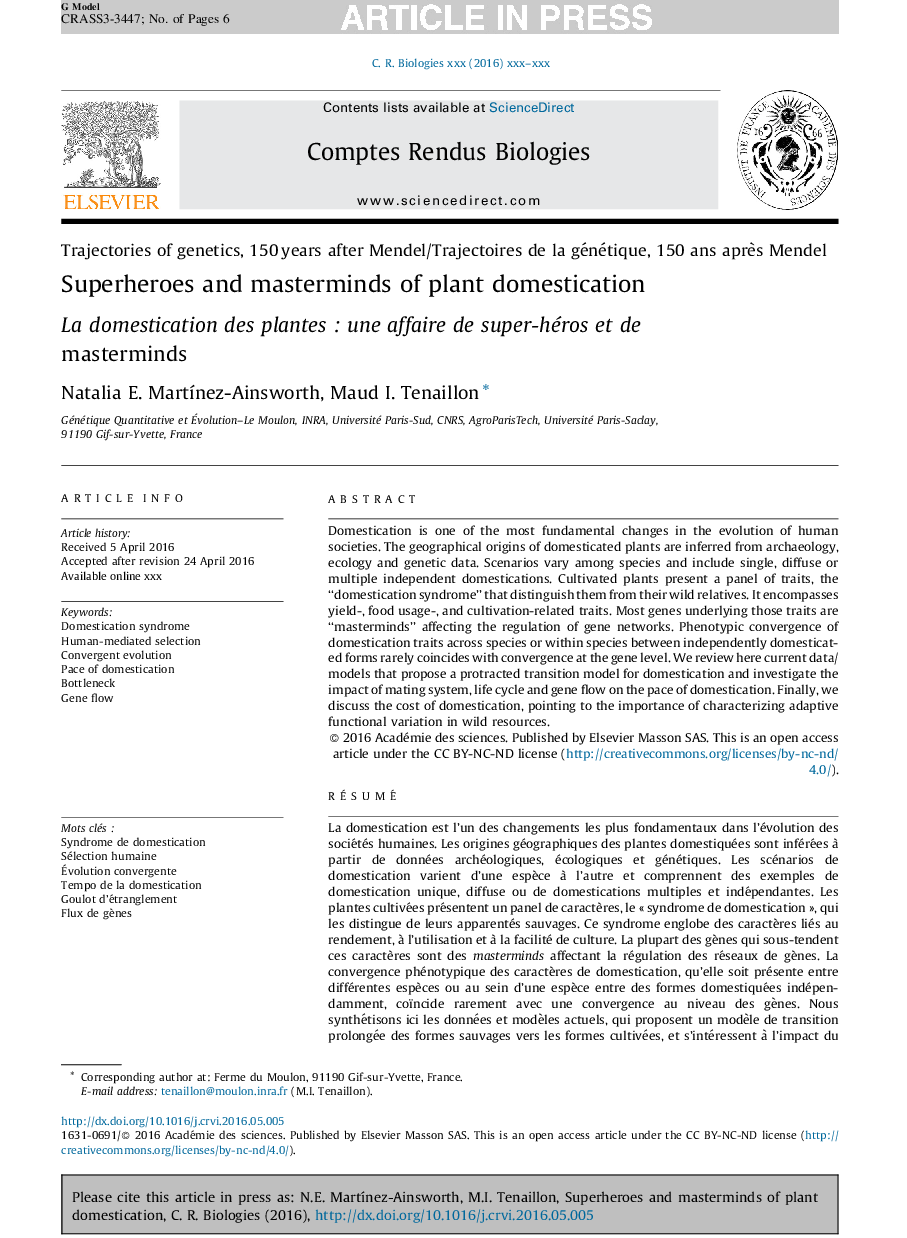| Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
|---|---|---|---|---|
| 5585547 | Comptes Rendus Biologies | 2016 | 6 Pages |
Abstract
La domestication est l'un des changements les plus fondamentaux dans l'évolution des sociétés humaines. Les origines géographiques des plantes domestiquées sont inférées à partir de données archéologiques, écologiques et génétiques. Les scénarios de domestication varient d'une espèce à l'autre et comprennent des exemples de domestication unique, diffuse ou de domestications multiples et indépendantes. Les plantes cultivées présentent un panel de caractères, le « syndrome de domestication », qui les distingue de leurs apparentés sauvages. Ce syndrome englobe des caractères liés au rendement, à l'utilisation et à la facilité de culture. La plupart des gènes qui sous-tendent ces caractères sont des masterminds affectant la régulation des réseaux de gènes. La convergence phénotypique des caractères de domestication, qu'elle soit présente entre différentes espèces ou au sein d'une espèce entre des formes domestiquées indépendamment, coïncide rarement avec une convergence au niveau des gènes. Nous synthétisons ici les données et modèles actuels, qui proposent un modèle de transition prolongée des formes sauvages vers les formes cultivées, et s'intéressent à l'impact du système de reproduction, du cycle de vie et des flux géniques sur le tempo de la domestication. Enfin, nous discutons le coût associé à la domestication, qui souligne l'importance de caractériser la variation fonctionnelle adaptative présente dans les ressources génétiques sauvages.
Related Topics
Life Sciences
Agricultural and Biological Sciences
Agricultural and Biological Sciences (General)
Authors
Natalia E. MartÃnez-Ainsworth, Maud I. Tenaillon,