| کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
|---|---|---|---|---|
| 7531708 | 1487636 | 2016 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Personhood, animalism, and advanced directives: The intersubjective and affective heart of the matter
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت
پزشکی و دندانپزشکی
مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
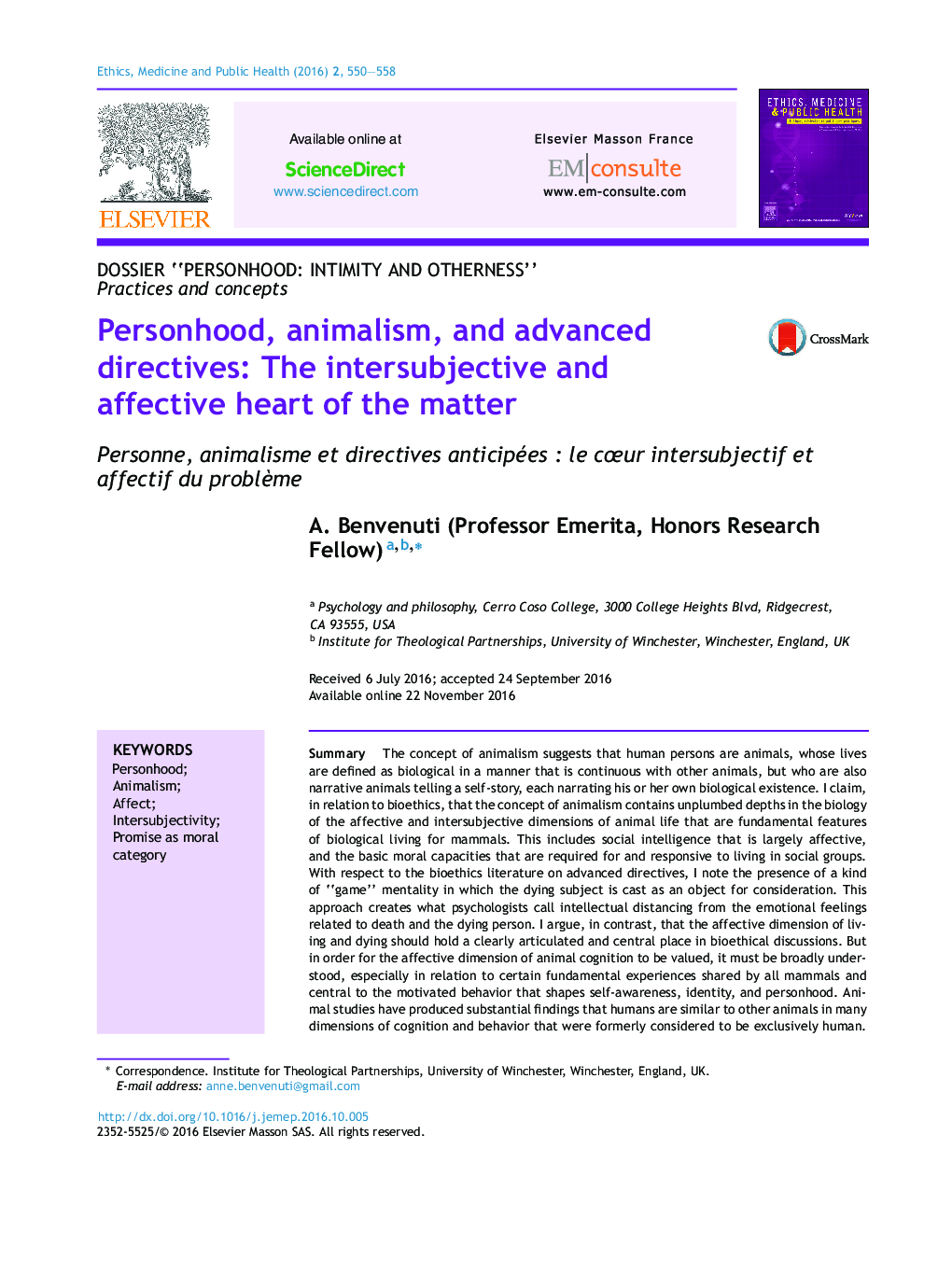
چکیده انگلیسی
L'animalisme est un concept qui veut que les humains soient des animaux dont les vies sont déterminées par leur biologie au même titre que les autres animaux. Toutefois, les humains racontent également leur propre histoire, ayant la faculté de faire le récit de cette existence biologique. Je soutiens que le concept de l'animalisme possède une profondeur inexplorée en ce qui a trait à la biologie de la vie animale et de ses dimensions affectives et intersubjectives, lesquelles sont des qualités fondamentales à la vie biologique des mammifères. Cette biologie inclut notamment l'intelligence sociale, une capacité principalement affective, ainsi que les compétences morales de base nécessaires et adaptées à la vie de groupe. Dans la littérature bioéthique sur les directives anticipées, j'ai remarqué la présence d'une approche frivole par laquelle un sujet mourant est introduit comme un objet à considérer. Cette vision entraîne ce que les psychologues qualifient d'éloignement intellectuel face aux sentiments liés à la mort et à la personne mourante. Je maintiens, contrairement à cette perspective, que la dimension affective découlant du fait de vivre et de mourir devrait être clairement articulée et occuper une place centrale dans les discussions de bioéthique. Or, pour que cette dimension de la cognition animale soit valorisée, elle doit être davantage comprise, en se penchant plus particulièrement sur les expériences fondamentales et communes aux mammifères, lesquelles façonnent la conscience de soi, l'identité et la personnalité. L'étude des animaux a permis de nombreuses découvertes suggérant que les humains sont semblables aux autres animaux au niveau cognitif et comportemental, arborant des facultés qui étaient autrefois considérées comme étant propres aux humains. Ces études ne réduisent toutefois point les humains à des êtres brutes ou même mécaniques. Elles élèvent plutôt les animaux en reconnaissant leur capacité de penser, de ressentir et d'avoir des considérations morales, une connaissance de soi et même une personnalité. Jaak Panksepp et Lucy Biven ont dressé la liste des états principaux vécus parmi les espèces mammifères et probablement parmi d'autres animaux tels que les oiseaux et les céphalopodes. Ces états affectifs sont si fondamentaux qu'ils sont à la fois une réponse à la perception sensorielle des objets autour d'eux et une propension physique à répondre d'une certaine façon à cette perception, puis un état émotif énergisant qui les pousse à agir. Ces états primaires-de quête, de soin, de peur, de jeu, de deuil, de désir et de colère-représentent le lieu affectif où la perception, la motivation et le sens subjectif d'appartenance se rencontrent. En d'autres mots, ces états primaires peuvent être désignés comme étant à l'origine de l'identité et de la personnalité, telles qu'elles sont vécues par n'importe quel animal. Après qu'Aristote ait émis sa théorie sur l'organisation hiérarchique des êtres, on a longtemps supposé que les humains se distinguaient des autres animaux de par leur capacité de pensée abstraite et rationnelle. Cette distinction a été réfutée de deux façons. Il a été prouvé que les autres animaux utilisent la pensée abstraite pour résoudre des problèmes et que les humains ne réfléchissent pas de façon exacte et rationnelle. La cognition humaine est fragmentée au mieux, et largement inconsciente ; elle n'est pas douée pour décrire la réalité telle qu'elle est. Le récit de soi est particulièrement prompt à l'erreur lié à la connaissance de soi. Bien que l'identité narrative de l'humain soit insuffisante, cela ne la rend pas pour autant sans valeur et ne réduit pas l'être humain à un être biologique mécanique. Par ailleurs, la biologie et la psychologie sont inséparables. Pour les humains, c'est la manière particulière d'exprimer une socialité inhérente-le cÅur intersubjectif de la vie des mammifères-qui rend notre valorisation de l'identité narrative importante. C'est le fait de partager avec d'autres humains la tâche unique de créer un récit de soi qui rend le soi narré si important. Nous comprenons emphatiquement le travail d'une vie narrée. C'est en ayant partagé cette façon de vivre et en ayant appartenu à l'autre dans la création de ce soi narratif que nous sommes unis dans la promesse d'honorer le travail de narration de l'autre. Sous cet angle, les directives anticipées constituent une promesse d'honorer le récit personnel de l'autre, en comprenant de façon intrinsèque la valeur de cet effort du récit de soi et en sachant que cette vie commune a façonné l'autre au cours de sa vie. Notre existence n'est rien d'autre qu'intersubjective, de notre premier à notre dernier souffle. C'est notre appartenance aux autres et notre existence parmi eux, ainsi que notre expérience de leurs constructions narratives qui nous unissent dans la promesse de respecter le récit de l'autre au meilleur de nos capacités, notamment en exécutant les directives anticipées autrefois narrées par un autre qui n'est plus parmi nous. Bien que nous ne pouvions établir en toute certitude morale que celui qui n'est plus en mesure de créer son récit voudrait encore ce qu'il a autrefois exigé, nous sommes en mesure de savoir que nous agissons en continuité avec son récit de soi. La volonté de supporter cette ambiguïté morale est au cÅur de la promesse de respect du récit de l'autre. Il est impossible de s'échapper de cette ambiguïté et de cette complexité, mais cette volonté est nécessaire pour vivre ensemble au centre de ces vies racontées.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ethics, Medicine and Public Health - Volume 2, Issue 4, OctoberâDecember 2016, Pages 550-558
Journal: Ethics, Medicine and Public Health - Volume 2, Issue 4, OctoberâDecember 2016, Pages 550-558
نویسندگان
A. (Professor Emerita, Honors Research Fellow),